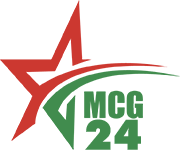Marocains du Monde : champions du monde sur le terrain, exclus des tribunes institutionnelles
Latifa CHAKRI
Vingt-trois ans après nos premières revendications de la société civile en 2002, la situation des Marocains du Monde (MDM) illustre un paradoxe frappant. Dans les stades et sur les écrans, ils portent haut les couleurs nationales, à l’image d’une équipe nationale auréolée d’un titre de « champion » du cœur et de la passion, galvanisant la fierté collective au niveau mondial, tant pour le monde musulman que pour le continent africain. Mais sur le terrain politique et institutionnel, ces mêmes Marocains restent relégués au banc de touche, privés de participation effective aux grandes décisions qui façonnent l’avenir du pays.
Une fidélité sans faille, un retour institutionnel absent par manque de confiance et de reconnaissance
L’attachement des MDM à leur mère patrie est indéfectible. Qu’ils soient au Maroc ou à des milliers de kilomètres, ils continuent de contribuer à la prospérité nationale par des transferts financiers record, par l’investissement, ainsi que par un rôle clé dans le rayonnement culturel et sportif. Pourtant, leur place dans le processus interne demeure quasi inexistante. Depuis l’adoption de la Constitution de 2011, qui consacre leurs droits dans de nombreux articles, aucune loi organique n’a été adoptée pour transformer ces principes en réalités.
Un pilier économique sous-exploité
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les transferts des MDM représentent entre 6 % et 8 % du PIB et participent, avec le tourisme, à couvrir plus de 77 % du déficit commercial du Royaume. En 2024, ces transferts ont dépassé 115 milliards de dirhams, confirmant leur rôle vital dans l’économie marocaine. Pourtant, cette force économique n’a pas trouvé son équivalent en termes d’intégration institutionnelle. Même les contrats locaux dans les consulats et ambassades sont souvent confiés à des Marocains venus du pays, et non à des MDM établis sur place.
Une mobilisation politique qui tourne sur place
Malgré leur rôle stratégique, les MDM subissent une mobilisation politique réduite à l’instrumentalisation. Ils sont célébrés lors des grandes fêtes nationales et sportives, mais restent absents des instances où se décide la politique publique. Les partis politiques les sollicitent pour « capter » leur image et leur influence, rarement pour leur expertise et leur voix.
La Fondation Mohammedia :
Dans ce contexte, la Fondation Mohammedia est présentée comme une innovation majeure : un « guichet unique » réunissant hauts fonctionnaires et administrations pour répondre aux besoins des MDM. L’idée est pertinente pour simplifier les démarches administratives, une sorte de « Fondation Hassan II » modernisée, le texte fondateur de cette nouvelle institution n’est pas encore finalisé.
En principe la Fondation n’est pas supposée résoudre la question de fond : l’absence de dispositifs d’inclusion institutionnelle. Sans réformes législatives claires, cette noble initiative risque de n’être qu’un palliatif à une exigence plus profonde.
Une victoire à construire en dehors des stades
Si la diaspora marocaine est capable de faire vibrer la planète entière lorsqu’elle se mobilise derrière une équipe nationale composée à presque 100 % de professionnels du football issus de la diaspora, elle pourrait, avec un cadre légal et institutionnel adéquat, jouer un rôle de « champion » dans le développement et la gouvernance du Maroc. Mais pour cela, il faut plus que des hommages ou des promesses non tenues: il faut une volonté politique ferme d’intégrer pleinement ces millions de citoyens dans le processus interne — au moment où nombre de pays africains nous devancent déjà dans l’intégration de sa diaspora.
Pour passer des slogans à l’action, plusieurs mesures concrètes s’imposent :
1. Adopter sans délai les lois organiques relatives à la représentation et à la participation politique des MDM, comme prévu par la Constitution de 2011.
2. Créer la « Région 13 » avec une représentation issue de la société civile, indépendante des logiques partisanes, pour éviter divisions et clientélisme.
3. Renforcer la gouvernance des institutions dédiées aux MDM, avec des nominations fondées sur la compétence, la transparence et l’expérience internationale, plutôt que sur l’appartenance politique.
4. Ouvrir systématiquement les emplois locaux dans les consulats et ambassades aux MDM installés sur place, afin de valoriser leur connaissance du terrain et des populations, mais il semblerait qu’il y ait un véto sur ce point depuis des années.
5. Mettre en place un mécanisme de concertation permanente entre la diaspora et les institutions marocaines, garantissant une écoute réelle et un suivi des propositions formulées.
Le Maroc ne peut prétendre à une stratégie d’influence internationale solide en laissant ses propres citoyens de l’étranger hors du jeu institutionnel. Comme sur un terrain de football, on ne gagne pas un match en laissant ses meilleurs joueurs sur le banc de touche. Et les virulents avec un carton rouge. Adopter une posture coercitive est la manière la plus douce d’organiser cette intégration qui reste un levier de soft power non exploité de manière constante.